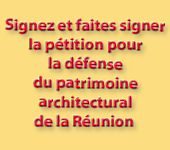La Petite-île Saint-Denis ne manque pas de monuments intéressants dont l’un des plus remarquables est, sans conteste, l’église Notre-Dame de la Délivrance. Erigée sur le flanc ouest de la rivière Saint-Denis, elle a vraiment fière allure : telle une figure de proue elle domine l’espace dégagé de la vallée et de l’océan. Elle est visible depuis le boulevard Lucien Gasparin, depuis les rampes de la Montagne, depuis la mer. Tout semble converger vers elle ; on dirait que la rue du Pont n’est rien d’autre que l’allée qui y mène. Celle-ci se termine d’ailleurs par un escalier à double volée (un dernier effort pour les pèlerins !) qui conduit au pied du sanctuaire ; ils ont vraiment été inspirés ceux qui ont décidé de construire à cet endroit ce lieu de pèlerinage.
La Petite-île Saint-Denis ne manque pas de monuments intéressants dont l’un des plus remarquables est, sans conteste, l’église Notre-Dame de la Délivrance. Erigée sur le flanc ouest de la rivière Saint-Denis, elle a vraiment fière allure : telle une figure de proue elle domine l’espace dégagé de la vallée et de l’océan. Elle est visible depuis le boulevard Lucien Gasparin, depuis les rampes de la Montagne, depuis la mer. Tout semble converger vers elle ; on dirait que la rue du Pont n’est rien d’autre que l’allée qui y mène. Celle-ci se termine d’ailleurs par un escalier à double volée (un dernier effort pour les pèlerins !) qui conduit au pied du sanctuaire ; ils ont vraiment été inspirés ceux qui ont décidé de construire à cet endroit ce lieu de pèlerinage.
Le vœu de Monseigneur Maupoint
L’église doit sa construction à un vœu, émis par le deuxième évêque de Saint-Denis, Monseigneur Amand René Maupoint. Alors que la frégate qui l’amenait à La Réunion en octobre 1857 se trouvait au large du Cap de Bonne espérance, le bateau fut pris dans une tempête si violente qu’un naufrage était à craindre. L’évêque pria alors la Vierge et promit, si le bateau, l’équipage et les passagers étaient sauvés, d’ériger une église qui porterait le nom de Notre-Dame de la Délivrance et qui serait un lieu de pèlerinage, en particulier pour les marins.
Il tint parole et en 1858 une paroisse fut créée ; une chapelle en bois fut bâtie, relativement modeste, qui s’avéra rapidement trop petite pour la population des environs. Cette chapelle se situait au nord de l’église actuelle. En 1891 un nouveau curé est nommé, le père Berthomieu, natif de l’Aveyron. C’est à ce curé-bâtisseur que l’on doit la construction de l’église telle que nous la connaissons. Les plans furent dessinés par l’ingénieur communal Auguste Bénard, puis approuvés en juillet 1893 par le conseil municipal de Saint-Denis. Les matériaux utilisés provenaient d’une église abandonnée, située à la Providence.
La construction dura cinq ans pendant lesquels le père Berthomieu s’investira complètement. Enfin, le 14 avril 1898, l’église sera consacrée par Monseigneur Antonin Fabre, dans un grand concours de notabilités et de fidèles.
Caractéristiques de l’église.
Cette église de la Délivrance est un bijou de l’art néo-gothique toscan à La Réunion. (Le style néo-gothique a été adopté au cours du 19ème siècle pour la construction de nombreuses églises en France.)

Elle est construite en moellons de basalte, maçonnés à la chaux avec des joints en relief. Sur la façade d’une vingtaine de mètres de haut se détachent quatre pinacles, coiffant des piliers. Au dessus de la porte centrale on distingue une grande rose. 28 statuettes en terre cuite, faites à Lyon représentant les apôtres et des saints décorent la façade. Deux statues plus importantes, celle de Saint-Joachim et de Sainte-Anne avec Marie enfant sont placées dans les niches des deux pinacles les plus élevés. Au sommet de l’édifice se dresse une statue en fonte de fer de la Vierge, copie d’une statue dite de l’Immaculée Conception de Pie IX, qu’avait admirée le père Berthomieu dans sa région natale.
La décoration intérieure
En 1898 au moment de l’inauguration il n’y avait pas de décor. Tout était blanc. C’est le frère Fulbert, père du Saint-Esprit qui réalise le décor polychrome (décor de végétaux et de motifs dans la nef et les bas-côtés ; la voûte centrale figurant un ciel étoilé). Le chœur est garni de toiles marouflées (1) représentant des scènes de la vie de la Vierge et de l’enfance du Christ peintes en 1904-1905 toujours par le frère Fulbert. A signaler également quatre vitraux des ateliers Bessac de Grenoble dont celui qui illustre le « vœu de Mgr Maupoint » lors de la tempête qu’il rencontra au large du Cap.
Le mobilier très intéressant a été entièrement créé à La Réunion. Il faut se souvenir que les églises à La Réunion ont été des chantiers de formation pour les artisans, en particulier les églises de Saint-Jacques, de la Rivière Saint-Louis, de Sainte-Anne et de la Délivrance. Les prêtres se sont systématiquement attachés à former les gens des quartiers. (Ne serait-ce pas de là que vient la vocation de la Rivière Saint-Louis pour l’artisanat du bois?) Ainsi, à la Délivrance, le confessionnal et la chaire entre autres sont l’œuvre de deux ébénistes réunionnais Jules Thierse et Joseph Antony. Ce mobilier a été fabriqué avec des bois de La Réunion spécialement consacrés à l’ébénisterie : natte, tamarin, benjoin et bois d’olive…Le maître-autel est également un joyau du néo-gothique à La Réunion, mais lui, proviendrait de la première chapelle de ce style dans notre île, construite par les Jésuites à la Ressource dans les années 1840, chapelle aujourd’hui disparue.
« L’église Notre-Dame de la Délivrance constitue un unicum à bien des égards, tout d’abord par son style néo-gothique…étonnant et exceptionnel à La Réunion, par les décors peints …qui ornent la totalité des parements intérieurs, par le nombre et la qualité…des objets mobiliers qu’elle conserve » déclare la commission chargée d’étudier la proposition de classement de l’église qui sera en définitive inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le 29 mars 1996. Elle est actuellement en cours de restauration.
La Délivrance, lieu de pèlerinage à la Vierge et à Saint-Expédit.
Comme l’a voulu Monseigneur Maupoint, La Délivrance est depuis l’origine un lieu de pèlerinage, consacré à la Vierge. L’apogée de ce culte a lieu le 24 septembre à l’occasion de la fête de Notre-Dame de la Délivrance, mais elle est également la première église à avoir accueilli une statue de Saint-Expédit. Cette statue a été installée en 1930 sur la demande de Mme Chatel. Celle-ci se trouvait à Marseille à la veille de la première guerre mondiale et tentait vainement de rentrer au pays. Elle pria Saint-Expédit dans une église de Marseille afin d’obtenir un billet d’embarquement pour La Réunion. Son vœu fut exaucé et Mme Chatel respecta sa promesse. Depuis lors ce culte s’est répandu dans tous les quartiers et toutes les couches sociales de La Réunion.
Il semble cependant que la hiérarchie catholique ne partage pas l’enthousiasme des fidèles : c’est ainsi que les Jésuites de Saint-Michel en Belgique contestent la réalité historique de Saint-Expédit et que le Pape Pie XI demandait que l’on enlevât ses images des églises, apparemment sans grand succès. De même si la paroisse de La Délivrance a publié un livret sur Saint-Expédit, on peut lire une certaine gêne entre les lignes de la préface du curé quand il émet le souhait que le livret « puisse aider à purifier (la prière des fidèles) envers Saint-Expédit de toute trace de magie, de superstition et de peur »
Si ce saint pas très orthodoxe est également l’objet d’un culte en France et en Belgique, c’est au Brésil que cette vénération prend des proportions hors du commun (grandes processions, messes avec une affluence très importante). On peut se demander en définitive si La Réunion n’est pas en petit ce qu’est le Brésil en grand, un lieu de métissage biologique et culturel où il est difficile de séparer le religieux du magique et l’historique du mythique (2).
DPR974
(1) Maroufler : coller une toile peinte sur un mur, un panneau de bois, une toile plus forte (Cf. Le petit Larousse illustré)
(2)Ceux que cette question intéresse peuvent se reporter au tome 8 de « A la découverte de La Réunion ». Editions Favory. De même un documentaire passionnant a été réalisé sur ce sujet à La Réunion, en Europe et au Brésil par Bernard Crutzen sous le titre : « Cachez ce saint…Sur les traces de Saint-Expédit, invite au voyage exploratoire ».
Read Full Post »