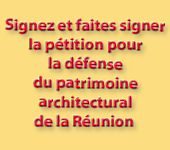« Allô, allô, habitants de l’Étang-Salé, des Avirons, de Saint-Leu, vous êtes tous concernés ! », peut on lire dans un appel qui circule actuellement sur les réseaux sociaux. Cet appel s’adresse à tous les Réunionnais car, selon son auteur, c’est de la qualité de vie dont il est question. Une qualité de vie qui serait mise en danger par le projet de carrière à Bois Blanc destinée à fournir les roches qui font toujours défaut au chantier de la nouvelle route du Littoral…
Au sujet de la carrière de Bois-Blanc à Saint-Leu – les Avirons
Allô, allô, habitants de l’Étang-Salé, des Avirons, de Piton Saint-Leu et de Saint-Leu, vous êtes tous concernés !
Je sors de la consultation publique. C’est une monstruosité. On peut tous se barrer du Sud-ouest ! Ça nous concerne tous, c’est maintenant qu’il faut réagir, cette enquête publique va déterminer si « OUI » ou « NON » les habitants acceptent cette carrière géante au bord de l’océan.
Ce n’est plus une possibilité mais un projet très sérieux qui démarrera dans quelques mois. C’est toute notre qualité de vie qui va basculer, 2 passages de camion par minute par jour sur la route du bord de mer (+/- 450 rotations par jour de 5h du matin à 20h le soir… oui, oui, oui soit 900 poids lourds !).
Fini le vélo sur la route bord’mer ; la fréquentation de la route va bondir de 900 poids lourds supplémentaires par jour… L’échangeur d’Étang-Salé les bains sera un giratoire géant à poids lourds ! Je ne vous parle pas de ce que cela va produire tous les matins au niveau de Saint-Paul puisqu’il y a 4 ou 5 h d’embouteillage terlà et que cela va ramener entre 480 et 600 PL en plus dans ces bouchons…
C’est la fin du développement touristique de toute la zone sud-ouest.
De la poussière très dangereuse pour la santé : Silice Cristalline (autant que l’amiante)… Elle s’étendra jusqu’à Saint-Leu vers le nord et jusqu’à Saint-Louis vers le sud, et bien-sûr énormément plus au dessus, vers Les Avirons : c’est à 1km du centre ville des Avirons (asthme, troubles de la santé, cancers…). On trouve 4 écoles et une PMI dans la zone ! C’est très sérieux pour les enfants et les personnes âgées.
Tirs de mine et fabrication d’explosifs rythmeront vos journées : on les entend à plus de 6km.
L’eau sera puisée depuis le bras de Cilaos ; elle disparaitra pour arroser une carrière car l’eau va soit disant permettre d’arrêter toute éventualité de propagation de poussière… Lol, on y croit ! Avec bien-sûr juste en dessous une nappe phréatique importante : c’est un réservoir pour l’île, il sert à la consommation, et sera pollué par celle-ci.
Cette eau (30.000 l/heure) mélangée à la poussière partira directement dans des bassins de décantation, avec un déversoir dans la ravine… Si, si, si… Et hop, il n’y aura JAMAIS de pollution… On le sait bien, ici les pluies fortes sont un mythe et le ruissellement aussi…
Alors que peut représenter une carrière à ciel ouvert de 55 hectares au bord de l’océan ?
D’ailleurs pas un mot sur la réserve marine : les milliers de litres de boue dans la zone littorale ne sont simplement pas envisagés, donc aucune dérogation, rien, et si cela arrivait (comme régulièrement !) on dira que l’on ne savait pas et ce sera la mort par envasement de toute la zone depuis le lagon de l’Étang-Salé jusqu’à Saint-Leu…
La réserve marine est totalement silencieuse sur ce sujet… alors que 500m plus loin, une station d’épuration n’arrive pas à rejeter ses eaux claires et traitées dans la réserve !
Cette carrière fera plus de 55 hectares et sera creusée jusqu’à 60m de profondeur durant minimum 5 ans. Ce seront des dommages irrémédiables sur le paysage, la faune, la flore. Tout sera pulvérisé.
Mais le pire reste à venir. Une fois l’exploitation finie, le site sera préparé pour — tenez vous bien — l’installation d’un incinérateur à déchets ! Et oui, c’est là qu’ils comptent le faire… Au bord de l’océan sur une zone calme, tranquille en plein développement touristique, à plus de 50km de toute grosse agglomération.
Voilà ! Si vous penser que cela ne vous touche pas, que vous ne verrez pas la différence, vous vous trompez, c’est toute la vie du sud-ouest qui est en danger !
Je ne plaisante en rien ; tout est écrit noir sur blanc dans le dossier consultable… en mairie ! Bien-sûr ne vous attendez pas à ce qu’il soit accusateur puisque c’est la société exploitante qui l’a rédigé, mais en prenant le temps de le lire, vous relèverez des aberrations ou des manques, il y a des paragraphes qui vous glacent le sang, d’autres, comme le NON sujet sur la pollution de l’océan, vous laissent sans voix… ou encore le calcul de propagation des poussières fines par vent fort : soit 28 km/h ! Lol jaune… En hiver, les alizés soufflent jusqu’à 80 km/h… Ou simplement que l’étude prend en compte les Avirons situés à 1km mais PAS Piton Saint-Leu situé à 2 km !
Il est capital de répondre à cette consultation publique, qui aura lieu en mairie de Saint-Leu, les Avirons et l’Étang-Salé, ces jours-ci. On peut y aller tous les jours et noter ce que l’on pense (son opinion et ses questions) dans un cahier fait pour cela, les jours de permanence servent à rencontrer le commissaire-enquêteur pour lui poser des questions.
Le commissaire consignera tout cela dans un rapport qu’il donnera à la société d’exploitation, puis celle-ci évaluera les contraintes, et redonnera le tout au commissaire qui transmettra avec l’avis des habitants, au préfet pour autorisation ou non.
C’est maintenant qu’il faut s’y opposer. Notre futur et celui de nos enfants en dépendent ! Merci de faire tourner largement !
Le commissaire-enquêteur sera dans les mairies suivantes selon ce calendrier :
Mairie de Saint-Leu
Mardi 26 mai, 9h/12h
Lundi 1er juin, 13 h/16h
Lundi 8 juin, 9h/12h
Lundi 15 juin, 13h/16h
Lundi 22 juin, 13h/16h
Mairie de l’Étang-Salé
Mercredi 27 mai, 9h/12h
Mercredi 3 juin, 13 h/16h
Mercredi 17 juin, 9h/12h
Mairie des Avirons
Vendredi 29 mai, 9h/12h
Jeudi 4 juin, 13 h/16h
Jeudi 18 juin, 9h/12h
Nos remerciements au site de 7lameslamer dont voici le lien