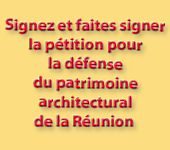Ou connaître notre patrimoine et le mettre en valeur…
Il y a à l’entrée sud de Saint-Denis un espace où le patrimoine « nouveau » rejoint le patrimoine ancien ; nous voulons parler d’abord du pont Vinh-San qui enjambe magnifiquement le fond de la rivière Saint-Denis, du boulevard lui-même avec ses jardins de manguiers et ses alignements de palmiers colonnes et de l’ancien hôpital colonial Félix Guyon au 95 rue Gibert des Molières (1), dont nous parlerons plus en détail ci-dessous…
Il y a là un ensemble très intéressant, mais un effort de réflexion est à faire pour relier les différents éléments et aménager l’espace de telle sorte que, à côté des flots d’automobiles, le promeneur, le flâneur, le touriste trouve également son compte. N’y a-t-il pas en particulier moyen d’imaginer une solution pour franchir le boulevard sans prendre une option gagnante sur la vie éternelle ? Ne pourrait-on penser à une sécurisation meilleure du pont pour qu’il ne constitue pas une tentation permanente pour les candidats à un monde meilleur ? Il devrait être également possible d’aménager un espace d’où l’on voie les enjambées du pont et d’où l’on domine le fond de la Rivière, ses jardins et ses gorges encaissées.
Tout près de là se trouve le site somptueux de l’ancien hôpital Félix Guyon et ses pavillons dont chacun est, en soi, un morceau d’architecture. Sous-employé, désaffecté, plus ou moins abandonné depuis la construction du C.H.D. il attend sa restauration et une nouvelle affectation digne de son cadre exceptionnel. Le temps est venu que la collectivité en charge de ce site (le Conseil Général si nos informations sont exactes, mais nous rechercherons davantage de précisions) élabore un projet où le culturel aurait sa part, car il y a une ligne à ne pas franchir pour ne pas tomber dans le tout commercial.
DPR974
Historique de L’ HÔPITAL FÉLIX GUYON.
L’Ancien hôpital colonial Félix Guyon, 95, rue Gibert des Molières, a été inscrit en totalité à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le 14 août 2000 y compris le terrain d’assiette. (2)
Principales dates
1846 : création d’un hôpital civil à la rivière Saint-Denis
1899 : achat du terrain du Camp Ozoux
1900-1904 : construction des pavillons
En 1846, une maison de santé privée existe dans le quartier populaire de la rivière Saint-Denis, destinée aux plus démunis. Les bâtiments se dressent entre la rue de la Boulangerie (rue de la République) et la rive droite de la rivière, autour d’une cour intérieure. Cet hospice est racheté par la colonie sous le Second Empire et devient le premier hôpital civil du chef-lieu.
A la fin du XIXe siècle, l’exiguïté des locaux et l’insalubrité du quartier imposent la recherche d’un nouveau site. Le choix se porte sur le quartier du Camp Ozoux. L’ingénieur Laniel, auteur des plans, prend le parti d’un établissement de type pavillonnaire, issu des réflexions communes menées en France depuis le début du XIXe siècle par les architectes et les médecins, en vue d’améliorer la santé publique et d’éliminer les facteurs de propagation du mal.
Une vingtaine de pavillons, affectés aux malades de 2e, 3e, 4e catégories, à la salle d’opération, ou aux logements des infirmiers et médecins et au logement des sœurs, sont disposés de part et d’autre d’une allée centrale. Les catégories correspondent au statut social des patients. Les plus aisés se trouvent à proximité de la rue, les plus pauvres, en fond de parcelle, près de la morgue, non loin du rempart. Les patients de première catégorie sont logés dans un vaste bâtiment à étage, le plus beau du site, disposant de varangues sur deux niveaux avec garde-corps en fonte d’art. Les services administratifs sont regroupés dans un bâtiment construit le long de la rue Gibert des Molières, au centre duquel se trouve un porche d’entrée en basalte taillé avec pilastres doriques, unique référence à la monumentalité et à l’ordonnancement propres aux grands édifices publics du XIXe siècle.
Tous les bâtiments ont fait l’objet d’un traitement architectural original, chaque construction se distinguant de sa voisine. C’est l’un des premiers chantiers publics où il est fait mention de pierres artificielles, réalisées à l’aide de moules, nouveauté dans la construction qui se généralise localement dans la seconde moitié du XXe siècle.
Le chantier se déroule de 1900 à 1904. C’est en 1920, après le décès du célèbre urologue, que le nouvel hôpital prend le nom de Félix Guyon, médecin né à Saint-Denis en 1831. En 1946, le département se voit attribuer la propriété des bâtiments du Camp Ozoux. Durant les dix années qui suivent il s’agit de l’unique hôpital du chef-lieu, jusqu’à l’ouverture en 1957 d’un nouvel établissement, actuellement en service, construit au début des rampes de Bellepierre.
(1) Dans la rue qui monte vers le C.H.D. de Bellepierre, sur la gauche, un commerce s’accorde quelques libertés historiques et orthographiques : Il porte fièrement l’enseigne de « Snack des Maulières »… Rappelons pour mémoire que Jean-Baptiste Gibert des Molières a été maire de Saint-Denis quinze ans durant (1855-1870).
(2) Document extrait, avec l’autorisation de l’auteur, de « Monuments historiques de Saint-Denis » de Bernard Leveneur. Editions Grafica 2005.