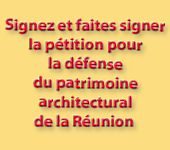Plus de 10 000 Réunionnais ont été engagés pendant la guerre 14-18. Ils ont vécu l’éloignement, la boue des tranchées, côtoyé la maladie et la mort, mais aussi rencontré des hommes et des espaces nouveaux. Pendant ce temps, comment les Réunionnais de l’île vivaient-ils ? Et après guerre quel hommage ont-ils rendu à leurs soldats ? Nous avons eu le plaisir d’interroger sur ce sujet Rachel MNEMOSYNE-FEVRE, docteure en histoire contemporaine, qui a soutenu en 2006 sa thèse (1) intitulée « Les soldats réunionnais dans la Grande Guerre 14-18 » (2).
Entretien avec Rachel MNEMOSYNE-FEVRE (suite)
II-1. Comment les Réunionnais ont-ils vécu au quotidien pendant ces 4 années de guerre ?
R. M-F : Les Réunionnais se mobilisent pour envoyer des contributions financières, réconforter les soldats et soutenir l’effort de guerre à La Réunion. On organise des loteries, des événements pour récupérer de l’argent. On fait notre guerre à nous dans l’île. Le gouvernement s’organise au cas où il y aurait un débarquement allemand. Par exemple protéger le Trésor Public dans les hauts de Salazie si nécessaire, mettre une drague dans le port pour éviter l’entrée des corsaires, interdire la TSF à tous les navires qui arrivent. Et, ce qui est très drôle, interdire l’atterrissage de tout aéronef, sachant que le 1er avion atterrit à La Réunion en 1929 ! Dès 1917, le premier monument aux morts se met en place à la Rivière Saint-Louis.
Dans la vie quotidienne, il va y avoir pas mal de problèmes de ravitaillement puisque il y a des pénuries. Et les prix augmentent. Il y a des soucis plutôt au niveau des denrées alimentaires. Le riz, qui est quand même l’aliment de base, pouvait manquer. Il y a des heurts, justement par rapport à ces « montées » du prix du riz et on va s’en prendre à une certaine population de l’île, notamment les chinois. La guerre signe le retour des cultures initiales qu’il y avait à La Réunion : manioc, maïs, en tout cas tout ce qui est racines. Et le gouverneur va faire stagner les prix. Il y a pénurie de pétrole. Sur l’île, les Réunionnais vont s’organiser pour trouver des palliatifs, par exemple l’essence de cannes, le rhum…
II-2. Quel impact la guerre a-t-elle eu sur l’économie de l’île ?
R. M-F : On pourrait croire que la guerre va impacter négativement l’économie de l’île. En réalité, comme les champs de betteraves, en France, sont plutôt vers l’est, ils ont été ravagés et donc l’économie sucrière a été florissante à La Réunion. Ce n’est pas qu’on produisait plus, mais on vendait plus cher. On exporte énormément, le rhum et le sucre et à des prix élevés puisque ces denrées deviennent rares.
Ce qui fait que les familles de producteurs sucriers vont faire encore plus de richesses pendant la guerre. Pour l’économie c’est pas si mal mais cela creuse encore plus le fossé entre les propriétaires et les autres. Les propriétaires peuvent se payer ce qu’ils veulent-en terme d’alimentation- alors que la population continue à être en état de pénurie.
II-3. Quel impact la guerre a-t-elle eu sur les modes de pensée ?
R. M-F : A leur retour, les soldats retrouvent leur famille, certaines dans des difficultés. Puisqu’ils n’étaient pas là, en général, les femmes ont pris le relais comme en Métropole.
Les hommes reviennent pour certains avec de nouvelles idées. Ils ont pu être au contact d’autres cultures. Il y a eu des confrontations d’idées. Et on voit au lendemain de la guerre, dès 1918, un article de journal qui parle de départementalisation alors qu’on est sous un régime colonial et que la départementalisation n’interviendra qu’en 46. Donc, on est dans un principe d’assimilation revendiqué un peu partout dans les colonies, pas qu’à La Réunion. C’est un vent. On a payé l’impôt du sang. Maintenant on a montré qu’on est Français, on a besoin de cette reconnaissance. Globalement, à la fin de la guerre, les colonies veulent l’assimilation. Et après il y aura le rejet, la demande de décolonisation. Les guerres mondiales ont contribué à la décolonisation finale.
Apparemment, il y a eu pas mal de traumatismes de cette 1ère guerre mondiale. Ce qui pourrait expliquer peut-être – je dis bien peut-être – le Régime de Vichy qui s’installera plus tard en 1940 à La Réunion puisqu’on a peur de rentrer dans une 2ème guerre mondiale. Donc on suit le gouvernement avec toujours cette idée de fidélité à la France. Ce qui est intéressant, c’est la réaction des soldats qui avaient fait la 1ère guerre à l’annonce de la 2ème. Une dame me racontait que son père s’est enfermé plusieurs jours quand il a appris qu’on entrait en guerre contre l’Allemagne en 1939.
II-4. Qu’en est-il de l’armistice et des hommages aux soldats ?
R. M-F : En novembre 18, à l’annonce de l’armistice, il va y avoir de grandes manifestations dans les rues avec des défilés pour fêter la victoire. C’est spontané. Mais les soldats ne sont pas encore revenus, il n’y a pas eu de retour massif. L’année suivante, en 1919, il y a une grosse commémoration du 11 novembre et on va commencer à avoir des soldats. On va rendre hommage, certes aux soldats, mais surtout à la victoire française. Et puis on va bien rappeler à la France métropolitaine qu’on a participé, contribué. Il faut bien voir à chaque fois en filigrane ce besoin de reconnaissance.
Dès 1917, il y a déjà le premier monument aux morts à la Rivière Saint-Louis. Ensuite il va y avoir les monuments de Saint-Denis, Saint-Pierre. C’est plutôt dans les années 20/30 qu’il y a réellement commémoration avec hommage aux soldats par le biais des monuments aux morts qui vont se développer. Il y a une espèce de vague qui existe à La Réunion et en Métropole. Les mairies vont ériger des monuments. Il y aura normalement les noms des soldats des communes. Ils n’y sont pas tous. Pourquoi ? On n’en sait rien. Par la suite, il y a les commémorations systématiques du 11 novembre qui se font partout.
III-2. Dans la conscience réunionnaise le traumatisme de la grippe espagnole n’a-t-il pas relégué au second plan le traumatisme de la guerre ?
R. M.F : En 1919, le Madona ramène les soldats avec la grippe espagnole. Grippe qui fait plus de 7 000 victimes que je mettrai sur le compte de la guerre car, si les soldats n’étaient pas revenus avec la grippe, on n’aurait pas eu autant de victimes sur l’île. Là, pour le coup, ce sont des civils qui vont pâtir de la guerre.
Cet épisode reste marqué dans les esprits puisque les Réunionnais restés sur l’île ont vécu la guerre de loin, à 10 000 km, même si, par le biais des soldats, on a perdu un être cher. Mais en même temps, on ne voit pas trop l’horreur du front. Là, on est sur une île cloisonnée, avec une diffusion fulgurante sur Saint-Denis, Saint-Pierre… Les Réunionnais sont frappés de plein fouet. Et directement. Enfants, femmes et quelle que soit la classe sociale. Et c’est vrai qu’aujourd’hui, on entend encore parler de cimetières-la-peste. Ils restent dans les esprits alors qu’on n’entend pas forcément parler de la 1ère guerre !
En fait, la grippe espagnole est une des conséquences directes de la guerre. Elle serait venue des Etats-Unis ou du Mexique. Elle a été quelque chose de phénoménal ! Elle a fait énormément de ravages et de victimes partout dans le monde, sur le Front de l’Est notamment. On les compte par millions.
III-3. Le mot de la fin : pourquoi et comment commémorer et enseigner ?
R. M-F : Le problème, c’est que l’homme va avoir tendance à avoir la mémoire courte. Il faudrait se rappeler que – sans faire de patriotisme acharné – des soldats sont allés défendre une cause et ils y ont quand même laissé leur vie. C’est une question de respect pour ces hommes et ce qu’ils ont dû subir, abandonner. C’est une leçon à ne pas réitérer – belles paroles dirons-nous -. Aujourd’hui ce serait pire vu ce que l’on est capable de faire !
Enseigner ce n’est pas rester sur le fait de guerre. Enseigner les tranchées, certes, mais cela reste très abstrait. A la limite, je préfère que les élèves regardent un film, un extrait d’Un long dimanche de fiançailles (3), c’est très représentatif. Mais pour comprendre vraiment, il faut s’imprégner réellement des choses – ce qu’on n’a pas le temps de faire clairement en classe -. Expliquer aux élèves quelles étaient les raisons. Se poser la question : est ce que ça valait le coup de laisser des millions de victimes pour finalement se rendre compte que la 1ère guerre c’est ni plus ni moins des intérêts économiques qui sont en jeu?
Le problème, c’est qu’actuellement, les guerres, la 1ère (et la 2ème), sont enseignées de façon binaire, et on reste dans l’idée : ça c’est les méchants, ça c’est les gentils. On a fait la guerre pour récupérer l’Alsace/Lorraine. Oui, c’est une des raisons. Sinon, il y a une grande guerre économique. Il y a tout l’enjeu colonial, il y a quand même tout cela derrière qui n’est pas abordé. Il faut aller plus loin. Ce n’est pas facile. Il faut relever le niveau de réflexion de l’élève, qu’il ait une vue plus globale pour avoir une vraie idée de ce qui a pu nous amener là et de ce qu’il faudrait éviter. Une connaissance un peu plus critique de la guerre et de l’histoire en général.
Avec tous nos remerciements à Rachel MNEMOSYNE-FEVRE
Entretien réalisé pour dpr par Marie-Claude DAVID FONTAINE
1. Thèse dirigée par les professeurs Yvan Combeau de l’Université de La Réunion et Jules Maurin de l’Université de Montpellier. Soutenue en 2006, à l’Université de La Réunion.
2. Lire le début de l’entretien dans l’article annexe de dpr : Les soldats réunionnais pendant la guerre 14-18.
3. Un long dimanche de fiançailles, film de Jean-Pierre Jeunet, 2004.
4. Photos de Marc David. Carte postale de la collection Hilaire Fontaine.