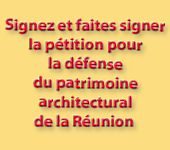En pleine ville de Saint-Denis, échouée sur une hauteur, une belle nef se déglingue, se démantibule, s’apprête à partir sur le côté de tantôt (1)… Le beau bâtiment d’autrefois gît dans un espace envahi de verdure ; sur sa poupe et sur ses flancs sa peinture, beige et ocre du temps de sa splendeur, grisaille et s’effrite…La superstructure toute envahie de carias a déjà été abattue…La carcasse, elle-même, ne tient plus que grâce à de puissants étais de bois fixés à l’intérieur comme à l’extérieur… L’effondrement est pour bientôt !….Cette ruine, c’est tout ce qui subsiste aujourd’hui de la Chapelle Saint-Thomas des Indiens, à l’angle de la rue Monseigneur de Beaumont et de la rue Montreuil.
Jadis pourtant son intérêt architectural et historique était tel que l’on a trouvé bon, dès octobre 1998, de l’inscrire à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Dans une notice de présentation l’A.B.F. D’Oriola ne mentionnait-il pas, après avoir décrit le bâtiment, que « Saint-Thomas des Indiens est un petit édifice qui participe pleinement à la structure urbaine de la ville ancienne de Saint-Denis » ?
Cela pouvait laisser supposer que les services de l’Architecture et l’Architecte des Bâtiments de France, Jonquères d’Oriola allaient faire en sorte que le site et le bâtiment soient protégés et qu’une restauration en bonne et due forme, en partie financée par l’état, soit mise en œuvre. Or que c’est-il passé depuis douze ans ? Bien peu de choses … Certes chaque nouvelle journée du patrimoine était l’occasion d’un branle-bas médiatique : on s’intéressait alors au bâtiment et à son histoire, on déplorait vivement que rien ne fût fait, on laissait espérer une action rapide et déterminée et, une fois la journée du patrimoine passée, le soufflé retombait, l’inertie reprenait le dessus, l’oubli se faisait encore plus pesant qu’auparavant.
Pour quelle raison laisse t-on ce bâtiment tomber en ruines ?
L’Etat a-t-il d’autres priorités ? Sans doute ! Ainsi, pour la Cathédrale et pour l’église de la Délivrance des travaux de restauration ont été réalisés ou sont en cours. Mais il est vrai qu’elles appartiennent à l’Etat pour la première et à la Commune de Saint-Denis pour l’autre, alors que Saint-Thomas n’est que propriété du Diocèse.
Est-ce uniquement une question d’argent ? Si tel était le cas, ne peut-on imaginer faire appel à d’autres contributeurs ? Car l’intérêt du projet dépasse assurément celui du seul Diocèse.
Quel projet pour Saint-Thomas ?
 Peut-être n’y a-t-il pas de projet convaincant pour l’utilisation future de la chapelle? Il nous semble pourtant qu’un projet très intéressant avait vu le jour et que la chapelle après avoir été au départ conçue comme outil pour la conversion des Indiens, pouvait en ce XXIème siècle répondre à d’autres aspirations : souvent les gens qui viennent de l’extérieur s’émerveillent de la tolérance qui caractérise la société réunionnaise, ne tarissent pas d’éloges quant à la bonne entente qui règne entre nous. (Mais au fait cette tolérance ne serait-elle pas trop souvent ignorance de ce qu’est l’autre et de ses valeurs ? Ne serait-ce pas une sorte d’indifférence qui a pris le relais du mépris voire de la répression d’autrefois ?) Cette bonne entente ne devrait-elle pas plutôt reposer sur une meilleure connaissance de l’autre ? Ne devrions nous pas engager le dialogue et l’échange pour plus de compréhension mutuelle en nous débarrassant de tout prosélytisme ?
Peut-être n’y a-t-il pas de projet convaincant pour l’utilisation future de la chapelle? Il nous semble pourtant qu’un projet très intéressant avait vu le jour et que la chapelle après avoir été au départ conçue comme outil pour la conversion des Indiens, pouvait en ce XXIème siècle répondre à d’autres aspirations : souvent les gens qui viennent de l’extérieur s’émerveillent de la tolérance qui caractérise la société réunionnaise, ne tarissent pas d’éloges quant à la bonne entente qui règne entre nous. (Mais au fait cette tolérance ne serait-elle pas trop souvent ignorance de ce qu’est l’autre et de ses valeurs ? Ne serait-ce pas une sorte d’indifférence qui a pris le relais du mépris voire de la répression d’autrefois ?) Cette bonne entente ne devrait-elle pas plutôt reposer sur une meilleure connaissance de l’autre ? Ne devrions nous pas engager le dialogue et l’échange pour plus de compréhension mutuelle en nous débarrassant de tout prosélytisme ?
Saint-Thomas pourrait dans ce cas devenir un centre de recherche, de réflexion et de dialogue, à l’instar de ce que fait le Groupe de dialogue inter-religieux de La Réunion, en élargissant toutefois les perspectives à l’histoire, à la sociologie, à la philosophie.
Histoire de la Mission indienne et de la chapelle Saint-Thomas (2)
– 1852 une mission des Indiens est créée sur l’impulsion de Mgr Desprez, premier évêque de Saint-Denis et le soutien financier de l’Association pour la Propagation de la Foi.
– 1855 La mission démarre réellement avec le père Laroche, jésuite parlant le tamoul. Son action durera jusqu’à son décès en 1868.
– 1860 : acquisition du terrain appartenant à la famille Vergoz
– 1860 à 1865 : construction de la chapelle Saint-Thomas des Indiens suivant les plans de Louis François Schneider.
– La mission ne rencontre pas le succès escompté : peu de baptêmes, peu de conversions. Devant l’immensité de la tâche la mission finit par se limiter aux seuls Indiens christianisés, originaires des districts catholiques de l’Inde.
– L’aide financière de L’association pour la Propagation de la Foi sera effective de 1852 à 1899.
– Jusqu’en 1900 un instituteur était encore chargé à Saint-Thomas de l’instruction d’une quarantaine de jeunes Indiens.
– En1952-1953 La presse réunionnaise signalait que la messe y était encore célébrée le dimanche en langue tamoule.
– 1951 L’installation des sœurs de l’ordre des Réparatrices (qui ont en outre des activités comme le catéchisme et la soupe populaire) donne un nouvel élan à Saint-Thomas.
– 1970, Au départ des Sœurs la chapelle est désaffectée et servira épisodiquement comme salle de sports pour le Collège Saint-Michel ou pour des expositions temporaires.
Hindouisme et catholicisme à La Réunion
Origine géographique de la population « Tamoule » de la Réunion.
La présence d’Indiens à La Réunion remonte aux premiers temps de la colonisation (Qu’on se souvienne entre autres des 13 Indo-portugaises de Goa qui firent souche à La Réunion), mais c’est après l’abolition de l’esclavage en 1848 qu’il a été fait massivement appel à des engagés, en particulier Indiens. Alors qu’en 1848 il n’y avait que 3440 Indiens recensés sur 110.000 habitants, leur nombre atteignait en 1858 plus de 36.500 sur 167.000 habitants.
C’est dans ce contexte que s’inscrit la Mission des Indiens : il s’agit de convertir les Indiens; ce n’est pas chose aisée pour de multiples raisons (dispersion des engagés sur les plantations ; un seul prêtre parlant tamoul, et surtout les Indiens n’avaient pas du tout envie de se convertir : en 1900 Mgr Fabre estime en effet que sur « 45.000 infidèles, 40.000 sont Indiens ». Claude Prudhomme (3) explique ainsi l’attachement des Indiens à leur religion : « la religion devenait pour les engagés le dernier lien avec le pays et les ancêtres et l’ultime moyen de préserver et d’affirmer leur identité ».
Le XIXème siècle consacre l’échec de la politique de conversion. Tout change à partir de 1887 lorsqu’une dépêche ministérielle impose l’application du décret de 1881 par lequel les enfants des immigrants nés dans la colonie ou qu’ils avaient amenés avec eux, reçoivent la nationalité française ; de là découlent la possibilité de travailler hors des plantations, de devenir éventuellement propriétaires. Beaucoup d’Indiens « adoptent, nous dit Cl. Prudhomme, la langue, les vêtements et les mœurs créoles » et le nombre de baptêmes augmente considérablement (4) La demande de baptême correspond assurément à une volonté de s’intégrer encore davantage à la société réunionnaise… « L’intégration n’entraîne pas cependant rupture avec la religion indienne dont de nombreux éléments sont transportés dans le catholicisme »…Mais ceci est une autre histoire !
DPR974
(1) Expression créole qui signifie « mourir »
(2) Pour les caractéristiques architecturales de la chapelle Saint-Thomas : Cf. « Monuments historiques – Saint-Denis de la Réunion » ; notices de B. Leveneur ; impression Graphica ; sept.2005.
(3) « Histoire religieuse de La Réunion » de Claude Prudhomme paru en 1984 aux Editions Karthala.
(4)Alors que le XIXème siècle consacre l’échec de la politique de conversion des Indiens, les deux premières décennies du XXème verront «l’adhésion » de ceux-ci au catholicisme.
(5)La chapelle porte le nom de Saint-Thomas, l’un des douze apôtres qui aurait converti les populations indiennes du Kérala au 1er siècle de notre ère.